L'Ariette I
Page d'accueil
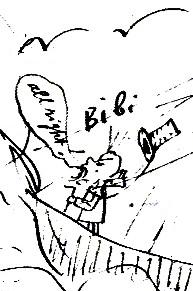 Le poème parut d'abord dans la Renaissance
littéraire et artistique du 18 mai 1872 sous le titre de Romance sans
parole. De fait, cette Ariette semble se résumer dans ces trois
mots : on oublie bientôt les premiers vers pour se laisser séduire par l'évocation
d'un bruissement multiple. La Romance sans paroles, ne serait-ce que
le paysage murmurant, métaphore ou écho de l'amour qui vient de s'accomplir
?
Le poème parut d'abord dans la Renaissance
littéraire et artistique du 18 mai 1872 sous le titre de Romance sans
parole. De fait, cette Ariette semble se résumer dans ces trois
mots : on oublie bientôt les premiers vers pour se laisser séduire par l'évocation
d'un bruissement multiple. La Romance sans paroles, ne serait-ce que
le paysage murmurant, métaphore ou écho de l'amour qui vient de s'accomplir
?
Et, s'il en est ainsi, y a-t-il simple transposition du
ressenti, ou bien fusion dans une nature à l'unisson des corps
et, de là, annexion et envahissement de l'âme ? Autrement dit,
ce poème, qui remplace les sempiternels discours de la
séduction ou du délaissement par celui de la "fatigue
amoureuse", ne recourt-il à l'effusion dans le paysage que
comme à un masque, ce qui pousserait alors à rechercher des
"sous-entendus torrides" derrière ce tableau de
nature, ou bien l'éloignement est-il irréversible ? La
dernière strophe revient certes au couple comme s'il n'avait
jamais cessé d'être présent, mais elle le réduit à une âme
en peine, éparse dans un paysage lui-même assez vide, comme si
l'on ne pouvait traverser impunément l'expérience de l'extase...
Synesthésies pour l'érotisme ou glissement dans l'absence,
donc ? L'enjeu n'est pas mince : c'est, en premier lieu, la
valeur à attribuer à Romances sans paroles, devenu titre
du recueil. C'est ensuite, selon l'option retenue, le choix,
probablement décisif pour la lecture du livre, entre un
impressionnisme labile et le "symbolisme latent",
fondé sur les "équivalences sensorielles", qu'a cru
déceler Octave Nadal. De là enfin, mais nous ne trancherons que
plus tard, il faudra poser, contre Nicolas Ruwet, le problème de
l'interprétation des parallélismes, compte tenu de la
temporalité qui se construit ou non dans le poème.
- C'est
l'extase langoureuse,
- C'est la
fatigue amoureuse,
- C'est tous
les frissons des bois
- Parmi l'étreinte
des brises,
- C'est, vers
les ramures grises,
- Le choeur des
petites voix.
|
- O le frêle
et frais murmure !
- Cela
gazouille et susurre,
- Cela
ressemble au cri doux
- Que l'herbe
agitée expire...
- Tu dirais,
sous l'eau qui vire,
- Le roulis sourd
des cailloux.
|
- Cette âme qui se
lamente
- En cette plainte
dormante,
- C'est la
nôtre, n'est-ce pas ?
- La mienne, dis,
et la tienne,
- Dont s'exhale
l'humble antienne
- Par ce tiède
soir, tout bas ?
|
1. Le premier sixain : le
glissement
C'est l'extase...
Cette ariette est, dans une très large mesure, construite par les verbes :
les C'EST en anaphore de la première strophe ; leur apparent affaiblissement
en CELA RESSEMBLE, TU DIRAIS de la strophe II ; enfin, la réapparition, dans
le dernier sixain, d'un C'EST, immédiatement affecté d'un N'EST-CE PAS ?,
lui-même repris par un DIS qui semble issu de TU DIRAIS. Tout se passe comme
si les phatiques (1) venaient
parasiter les verbes supports de la description, comme si l'esquisse d'un dialogue
prenait le relais d'une tentative de définition totalement impersonnelle au
départ. La parole chassée ferait-elle ainsi retour, en même temps que le couple ?
Ces sortes de filiations doivent, en tout cas, nous inciter à prendre en compte
l'énonciation en même temps que la "chronologie" du poème.
Le C'EST initial est au demeurant un impersonnel, un "présentatif"
(2) bien particulier.
Il tend, dans "C'est l'extase...", à donner d'une situation psychologique,
d'une expérience vécue, une définition globale, totalisante. Plus que d'un impersonnel
d'ailleurs, c'est d'une forme d'impersonnalisation qu'il faudrait parler
: elle gomme un "je" ("ce que je vis", "ce que je ressens")
ou un "nous" pour donner toute la place à l'impression, au contenu
ainsi illimité de la sensation, au moment où celle-ci se produit.
Et, par conséquent, l'identification qui nous est proposée ressemble à une
tentative paradoxale pour définir ce qui ne peut être désigné, ou qu'on refuse
de désigner (le "je" ou le "nous" en situation) — une
énonciation de soi par substitution. Un sujet s'efface pour laisser parler ce
qu'il éprouve, ce qui le possède. Le prédicat devient le thème, et le C'
à la fois n'a pas de référent et ne cesse de renvoyer au "je" comme
absent, ce qui réalise déjà littéralement l'EXTASE — la sortie de soi.
La valeur de ce mot, en effet, n'est pas dans la connotation mystique et baudelairienne
qu'on s'est plu à souligner. Au contraire, peut-être (3).
Elle naît de ce qu'EXTASE annonce EXPIRE (strophe II) et EXHALE (strophe III)
— sans compter les mots de la famille d'EXIL dans la suite du recueil.
Dans ce micro-système, le préfixe est souligné et le sens étymologique d’extase
réactivé (mais sans doute vaudrait-il mieux parler d'un travail sur la morphologie
plutôt que d'insister sur l'étymologie). On comprend d'ailleurs qu'un énoncé
comme "J'éprouve une extase" aurait été ici un pur non-sens —
ce qui ne sera plus le cas à la fin de Birds in the night. Encore fallait-il
créer ou trouver la forme grammaticale qui convienne.
Si l'association entre EXTASE et la forme d'impersonnalisation
apparaît parfaitement logique, Verlaine déconcerte lorsqu'il
réitère sa tentative et propose de nouvelles équivalences ou
"définitions" avec des modifications telles de l'une
à l'autre que, sauf à poser que la succession vaudrait
métaphore en vertu du principe jakobsonien d'équivalence, toute
identification nous est interdite. Il ne s'agit même pas, à
défaut, d'approximations superposables : des vers 1-2 aux
suivants, on passe d'une évocation érotique à une description
de la nature.
C'est l'extase langoureuse,// C'est
la fatigue amoureuse
Même du premier au deuxième vers, il y a glissement. Certes, langoureuse
rime si richement, sinon si habituellement, avec amoureuse que les
deux adjectifs, se contaminant dans l'idiolecte poétique, peuvent être regardés
comme de presque synonymes. L'association en rappelle d'ailleurs une autre,
fréquente chez Verlaine : coeur-langueur. Mais ces vers ne sont pas
seulement unis par un parallélisme grammatical : il y a aussi un chiasme
sémantique et fatigue, par récurrence, vient réveiller un sens premier
de langueur : affaiblissement, perte de vigueur. En outre, le
vers 2, par sa tension vers le prosaïsme et le terme "propre", dénonce
ce que le premier pouvait avoir d'artificieusement poétique, tout en dénotant
— fatigue (4) contre extase
— une succession et une sorte de dégradation. Au lieu de deux définitions
équivalentes d'un même moment comme semblait l'annoncer l'anaphore, nous avons
un avant et un après.
N'oublions cependant pas que l'avant que serait le vers
1 par rapport au vers 2 est lui-même un après —
l'après-amour, l'oubli de soi, qui justifie tous les glissements
ultérieurs : si les C'EST peuvent mettre sur le même plan
âme et nature, c'est que l'âme se répand au dehors, se
transfuse dans le paysage. L'ariette commence à dire des
changements, mais comme si ceux-ci ne parvenaient pas à la
conscience, comme s'il continuait d'être question de la même
chose : ce que suggère la rime langoureuse/ amoureuse
dans ce qu'elle a de redondant. Ce piège// D'être présents
bien qu'exilés (Ariette VII) : il y a tension entre
le présent permanent des verbes répétés et le glissement
— déjà entamé quand commence le poème — vers la
fatigue, la nature, la mort..., entre l'érotique et le paysage.
En sortira le motif de l'exil imparfait, si présent dans les Ariettes.
C'est tous les frissons des bois//
Parmi l'étreinte des brises
C'est donc nécessairement que le vers 3, C'est tous les
frissons des bois, introduit la nature. Mais une nature qui
se dégage à peine encore de ce qui précède : elle reste
érotisée, par frissons comme brises le sera
par étreinte. D'autre part, C'est tous les frissons,
dans la tension entre le singulier et le pluriel, tend à
maintenir une unité d'impression. La construction est toutefois
inséparable de celle du vers 4, où l'on n'a voulu voir que la
recherche du "vague". De même que C'EST appelle
normalement le singulier, PARMI réclamerait le pluriel ou, à
tout le moins, un substantif d'illimitation ("parmi le
monde"/ "l'air"/ "la plaine"/ "la
foule"...). Or étreinte est un singulier, et même
le singulier d'un nom qui impose une idée de resserrement, de
constriction. Comment interpréter cette interversion des signes
du singulier et du pluriel, cet échange des nombres ?
On pourrait soutenir que le vers 4 est chargé de réparer
l’ "écart" apparu au vers 3, que son
singulier surprenant compense le pluriel dénié. Mais les deux
constructions semblent bien plutôt aller dans le même sens, se
renforcer mutuellement : c'est tous les frissons
comme parmi l'étreinte marquent la tension entre le
fini du corps amoureux et l'effet d'illimitation produit par
l'entrée en scène de la nature (le paysage n'est
représenté ici que par des pluriels : des bois, des
brises). La "transposition" de l'érotisme au
paysage est aussi une transformation de l'érotisme par le
paysage, une pluralisation.
S'ensuit une désérotisation : nous prendrons ici le
contre-pied des analyses d'E. Zimmermann [Magies, pages
66-67] et d'O. Nadal [pages 110-111]. Selon la première,
Verlaine aurait besoin de la dualité des thèmes pour pallier
les insuffisances du vocabulaire affectif — le lexique
naturel ne serait qu'un relais pour dire la jouissance. Selon le
second, Verlaine chercherait plutôt à éluder, par la
transposition ("la voie poétique"), la grossièreté
inhérente à tout érotisme représentatif. Dans les deux cas,
le thème "descriptif" devient subordonné, et détour,
métaphore du thème érotique. Ce qui se paie, bien sûr : ainsi
sa logique des "équivalences sensorielles" oblige
Nadal à "isoler" ou "supprimer les attributs de
nature", c'est-à-dire à biffer tout ce qui fait allusion
au paysage, par une sorte de censure à rebours, qui chercherait
à démasquer les mouvements corporels de l'amour dans le roulis
ou dans les "intersections d'aspect entre ce qui est du
monde et ce qui est de l'être". Quant à E. Zimmermann,
elle est contrainte de traquer le vague et les méprises pour
recenser les métaphores d'un état de sensibilité indicible :
"une réalité psychologique profonde se reflète dans cet
univers poétique incertain".
On ne peut pourtant attribuer à l'un des thèmes un
privilège d'ordre, somme toute, référentiel, et à l'autre un
statut métaphorique "par défaut". Le poème définit
lui-même clairement la relation existant entre les deux, ou
plutôt l'absolue nécessité de passer de l'un à l'autre. Il
n'y a pas juxtaposition, détour ou transposition, voire
catachrèse, mais bien un glissement, qui ne se déclare
jamais comme tel et que nous retrouverons souvent ailleurs.
Ce glissement, déjà lancé quand commence le poème, travaille
le syntagmatique, opérant une modification continue du thème. Le
poème n'a plus dès lors un sujet (la description d'un
certain état psychologique), mais est et fait un changement
de sujet — son sens se résumant largement à la
"construction" de cette labilité. Avec tous les
éléments de tension que cela implique, l'anaphore suggérant un
effort recommencé en même temps que sans cesse déjoué.
C'est, vers les ramures grises,// Le
choeur des petites voix.
Or cette tension fait plus que s'estomper à la fin de la
strophe : parce que le vocabulaire érotique disparaît, au
profit apparemment de la seule "description" ;
parce que les sensations cénesthésiques qui gardaient trace du
corps dans l'évocation du paysage (frissons, étreinte)
cèdent la place à un découpage relativement banal entre vue
(vers 5) et ouïe (vers 6) ; parce que l'interversion des
composants de la phrase (cette fois, le complément de lieu passe
en premier, sous forme d’incise), la suraccentuation du
dernier présentatif qui en résulte et la fin sur une rime
vocalique prennent valeur conclusive ; parce que le mot chœur,
le plus important ici dans la hiérarchie syntaxique, est un
terme collectif qui résout l'opposition entre singulier et
pluriel...
Pourtant, le glissement continue en dépit de cette marche
vers la conciliation. Le plan visuel suggéré par les vers 3-4
(plan général, pris de haut et de loin : les vents étreignent
la forêt) se rétrécit considérablement, comme si nous nous
étions rapprochés des arbres pour nous intéresser à un
détail. Qu'on compare les deux mots bois et ramures
: le glissement synecdochique est net, et le petites du
vers suivant semble le confirmer. Une autre modification s'amorce
dans le même temps : alors que tous les frissons des bois
faisait thème au vers 3, les arbres ne sont plus ici au centre
de l'attention. Ils sont bien évoqués, une fois encore,
immédiatement après le C'EST, mais vers les ramures grises
n'est plus qu'une indication de lieu, détachée par les
virgules. Cet abaissement dans la hiérarchie
syntaxique-thématique prépare le privilège accordé au sonore
et esquisse le mouvement qui va faire succéder à l'arbre
l'herbe, puis l'eau. Aucun paysage ne se construit ici : nous
assistons à des substitutions. Inutile donc d'essayer de
retrouver une nature ardennaise avec bois et rivières !
La suggestion d'un soir ne fournirait elle-même qu'une
explication référentielle facile. Le choix de l'adjectif grises,
celui de la préposition vers relèvent beaucoup moins
d'un "sens de la notation juste" qui passerait ici par
l'imprécision, que d'une systématique du glissement. EXTASE,
FRISSONS annonçaient déjà des "décalages" —
plus rien ne coïncide avec soi-même, tout excède ses limites,
cela tremble. VERS, dont l'effet se cumule avec celui de la
virgule qui détache le complément, décale de même la
localisation — sans pourtant l'éluder. Le son est à
côté, du côté d'un bois qui tout à l'heure frémissait,
comme si ses contours se défaisaient. La couleur subit le même
sort que le dessin : la touche de gris semble mal posée, comme
si elle avait glissé du soir aux arbres (hypallage ?). Le
"vague" n'a donc que faire ici : lié prosodiquement à
fRIssons et à bRIses, le mot gRIses
participe d'un paradigme du bougé.
Pourquoi la notation auditive, le choeur des petites voix,
semble-t-elle apte à conclure le mouvement ouvert par C'est
l'extase ? Parce que le sonore dispose d'une autonomie
certaine : en comparaison du cénesthésique-kinesthésique des
premiers vers, par définition très lié au corps, en
comparaison même du visuel décalé du vers précédent, les voix
se passent de tout support, elles sont "détachées".
Les oiseaux ne seront pas nommés et resteront littéralement
invisibles. Ce son indépendant réalise l'extase.
Son autonomie se renforce d'ailleurs du redoublement quasi
pléonastique chœur / voix : cette réitération
(dans la mesure où nous mettons entre parenthèses la fonction
d'oblitération du pluriel qu'assume aussi chœur)
tend en effet à abstraire encore un peu plus le sonore. La voix
devient oubli du corps, et l'on comprend alors mieux que les
oiseaux n’aient pu être assignés à résidence
"dans" les ramures.
2. Le deuxième sixain : le
virement, vers le négatif et la mort :
La deuxième strophe, la plus souvent citée, la plus louée
à défaut d'être véritablement expliquée, apparaît aux
commentateurs comme une réussite exemplaire de Verlaine dans le
traitement du sonore, des "sensations ténues" [Claude
Cuénot, 1963, page 400]. Pourtant, selon nous, le glissement y
continue et menace la primauté du prétendu mimétisme.
O le frêle et frais murmure !
Certes, allié à la forme nominale de la phrase, le rythme
fermé de O le frêle
et frais murmure !,
habituel à ce type de séquences exclamatives chez Verlaine,
figure un moment d'"arrêt", de délectation sensible.
L'on a souvent cédé à la tentation de parler, à son propos,
d'harmonie imitative. Mais à quoi référer cette succession de
[f] et de [m], de [e] et de [y], en attendant les
[s] et [z] du vers suivant, sauf à s'abriter derrière une
"polyphonie", celle du choeur des petites voix
? Notons plutôt que Verlaine recourt ici à des onomatopées
lexicalisées et, avec MURMURE et SUSURRE, à des onomatopées
qui opèrent par redoublement. Ce n'est pas la substance sonore
qui compte, mais la répétition presque intégrale de la
syllabe. D'où l'intégration rétroactive à ce schéma des deux
adjectifs quasi homophones, sous la forme /l¤frelefre/.
Par ce moyen, Verlaine détourne à son profit un fait de
lexique, en amorce l'intégration au discours, en fait système
dans le poème. Le resserrement des accents, ou plutôt
l'alternance brève-longue (— v — v —v —),
serait d'ailleurs de nature à faciliter la perception de ces
redoublements.
Cela gazouille et susurre
Le vers 8 continue dans le mimétisme lexicalisé, voire y met
le comble. S’identifiant au sémantisme de gazouille et
susurre, le pronom est un véritable sujet interne, qui
suggère une vie propre, une anomation du son. De ce point de
vue, il opère déjà à bonne distance de C'EST dans la mesure
où celui-ci impersonnalisait à partir d'un "je"
effacé. CELA, parce qu'il ne renvoie pas à ce qui précède,
permet de reprendre l'essai de "définition" sur
nouveaux frais et, en confondant le sujet avec le procès,
suggère un pur bruire. La construction est solidaire du recours
à l'onomatopée.
Cela ressemble au cri doux// Que
l'herbe agitée expire...
Après cette autonomisation du sonore aussi poussée qu'il
était possible, tout ne peut que retomber. Nous assistons
maintenant à une nouvelle tentative d'identification, qui ne
réussit qu'imparfaitement : Cela ressemble
au cri doux... Une source sonore nous est proposée :
l'herbe. Par rapport aux ramures de S. I, dans la même
thématique végétale, c'est un abaissement, que la référence
suivante, aux cailloux, ne fera que continuer : on
glisse vers l'inanimé : oiseaux / herbe / cailloux, et on est
aspiré par le bas. Une descente-noyade et une mort.
Car, si expire..., transitif, suggère grâce aux
points de suspension un souffle qui se prolonge, on peut aussi
deviner, sous les mêmes trois points ainsi placés juste avant
les vers de l'eau, l'ellipse d'une mort. La position du verbe en
fin de phrase, en fin de vers, n'aide nullement à éloigner
l'idée d'une agonie, non plus d'ailleurs que ne le fait le
choix, en position d'objet, de cri. De surcroît, agitée,
faute de complément d'agent, évoque un trouble qui ne viendrait
pas de l'extérieur (cf. "un malade agité", "une
nuit agitée") : qu'on compare avec les vers homologues de
la première strophe, où les frissons étaient
expliqués par l'étreinte des brises. Or expirer
confirme que le cri sort de l'herbe, au lieu de provenir du
passage du vent. Bruit doté d'une origine mais sans cause,
l'expiration s'apparente bien à un dernier souffle.
CELA RESSEMBLE est, bien entendu, à rapporter à C'EST :
l'identification s'affaiblit, dégénère en analogie, en
comparaison. Mais dire comparaison implique que CELA puisse être
doté d'une identité, pourvu d'une référence qui, jusqu'à
présent, ont toujours été refusées au pronom démonstratif.
La superposition Cela gazouille / Cela ressemble
n'incite en rien à conférer au deuxième démonstratif un
statut de pronom représentant. Il faut alors comprendre que le
verbe "ressembler" est à mettre sur le même plan que
les verbes de bruit qui le précèdent. Les sensations auditives
sont elles-mêmes des évocations, des suggestions, des
semblances : des opérateurs de glissement. Le vers 9 ne
pose donc pas, comme on pourrait le croire, une identification
approximative, et CELA reste sujet interne. A preuve peut-être
le choix de la variante suivante, TU DIRAIS : elle laisse
entendre qu'une parole pourrait émerger de la semblance, parce
que celle-ci est encore une voix, un murmure. La dégradation de
l'être de S. I a laissé la place à un air, qui
est aussi bien "romance sans paroles" qu'apparence.
Cependant, aller jusqu'à vraiment "dire" serait encore
trop : ce serait remonter jusqu'à la parole alors que l'air ne
peut que suggérer. D'où le conditionnel.
cri doux, roulis sourd
Mais arrivons-en à la nouvelle variation sonore qui nous est
proposée : au cri
doux. En fait de
"sensation ténue", c'est plutôt d'une contradiction
dans les termes qu'il s'agit, et le contre-accent (en opposition
à l'alternance brève-longue du vers 7 ?) souligne la tension,
fortifiée de surcroît par une sorte d'oxymore phonétique : en
effet, Verlaine exploite ici "l'opposition distinctive entre
voyelles graves bémolisées ([u], [o]) et voyelles aiguës non
bémolisées ([i], [e])" qu'évoque R. Jakobson dans La
charpente phonique du langage [Editions de Minuit, 1980,
page 150]. Le contre-accent du vers 12, sur Le roulis sourd, sera construit de la même
façon, en attendant le triple sommet accentuel de l'Ariette
III : O bruit doux de la pluie... Souvenons-nous de la
remarque de Mallarmé sur les sonorités contrastées de nuit
et de jour : la même pensée datée pourrait être à
l'oeuvre dans cette figure.
Ces deux contre-accents en eux-mêmes identiques participent d'une construction
prosodique plus étendue, qui tend à les inscrire dans des contextes inverses.
(... Au cri doux) // Que l'herbe agitée expire : le vers 10, à
l'exception d'un [¤] initial, ne comporte
que des voyelles antérieures, entre lesquelles les accents sélectionnent celles
qui s'échelonnent de l'ouvert au fermé : / ¤ e a i e e i / (5). En revanche, dans : ... sous l'eau qui
vire// Le roulis sourd des cailloux, ce sont les [u] qui finissent par l'emporter sur les [i]. Faut-il
voir dans ce contraste un moyen de marquer le triomphe du sourd sur
le cri ?
D'autre part, les voyelles à la rime sont, après le [y]
redoublé des vers 7 et 8, les [u] et les [i] : trois voyelles de
même formant inférieur, c'est-à-dire fermées (diffuses), qui
ne se distinguent que par leur plus ou moins grande acuité. La
prédominance restant aux deux extrêmes : [i] aigu et [u] grave.
On a ainsi l'impression que l'opposition [i]~[u] naît d'une
dissimilation à partir du [y].
Ce que marquent les deux contre-accents ne serait plus alors
une opposition phonologique pure et simple, mais en grande partie
une opposition prosodique, (re)construite par cette deuxième
strophe.
Tu dirais, sous l'eau qui vire,// Le
roulis sourd des cailloux
- TU DIRAIS arrive donc comme une variation de CELA RESSEMBLE ou, sur fond
de parallélisme avec les vers 5-6, comme une nouvelle "dégradation"
de C'EST : hésitation, identification atténuée. Mais qui introduit subrepticement
un TU encore englué dans l'impersonnel (il est proche d'un ON), et un verbe
DIRE apparemment synonyme de CROIRE. Or la strophe III va imposer une lecture
par récurrence qui fera de ces éléments les premiers d'un incertain dialogue.
Celui-ci aura ainsi émergé de la semblance, alors qu'à l'inverse, le C'EST
initial était un effacement du JE. Retour du personnel refoulé ? Le paysage
et le sonore surgissaient de l'impersonnalisation, la mort du bruit (r)amène
le TU. Celui-ci prend donc en quelque sorte le relais du sonore, et s'accompagne
d'un dirais quand il s'agit en fait d'entendre. D'autre part, là
où il y avait bruit, nous ne trouvons bientôt plus que suggestion de bruit
: si Verlaine, en effet, écrit "roulis" et non "roulement",
ce n'est pas parce que ce dernier mot serait "trop long et lourd pour
évoquer un clapotis léger" (6), mais parce qu'il s'agit
d'effacer le sonore. Et en définitive, le seul terme qui évoque ici un bruit,
c'est sourd, qui le fait négativement et que motive par superposition
le SOUS l'eau du vers précédent :
Tu dirais, SOUS l'eau qui
vire,
Le roulis SOURD des cailloux.
|
Dans cette après-mort ou cette "vie sous-marine"
verlainienne, on retrouve l'habituel tournoiement. En effet, qui
vire et roulis suggèrent un mouvement de
"berceau" que viennent appuyer des espèces de
renversements prosodiques : alternance des [i] et des [u] ou [o],
et surtout inversions, accompagnées d'un glissement de la
position pré-accentuelle à sous-l'accent, pour /iR/ : cRI Doux - tu DIRais - qui vIRe,
et pour [u] : sOUS l'eau
- ROUlis - sOURD. On rapprochera ces
relations de celle qui se noue entre les rimes brises-grises
et expire-vire.
Le déplacement du contre-accent, de la fin du vers (9 : Cela
ressemble au cri doux) au milieu du vers (12 : Le
roulis sourd des cailloux)
semble figurer, en rapport avec la superposition sous-sourd,
un étouffement — une sourdine. Mais sourd est
encore motivé d'une autre manière. Les échos du vers 8 au vers
12 (Cela GAZOUILLE et SUSURRE / Le roulis SOURD des CAILLOUX)
se font au profit du [u] et du [s'R], effaçant le [z] si
fréquent dans la première strophe sous la forme [R'z] : sourd
s'oppose ainsi à langoureuse, amoureuse, grises
et brises, la transition étant assurée par frissons
et ressemble ([R-s]) ainsi que par susurre
([s'R]). Cailloux participe de cette série comme écho
de gazouille sans [z], ce qui le motiverait comme perte
de la vie, du "frémissement" — silence. Nous
avons ainsi dans cette strophe II toute une organisation
prosodique en [i] et en [u], dont la valeur ne saurait
probablement être déterminée terme à terme, mais qu'on peut
décrire globalement comme une inversion généralisée,
aboutissant à privilégier [s] sur [z] et [u] sur [i]. Donc
aboutissant à sourd.
Ainsi, la délectation du bruissement n'aura pas réussi à
arrêter le mouvement — vers le bas et le sourd. Parce que
le sonore est semblance, air et, comme tel, condamné à
se nier, à glisser dans la mort. Mais c'est aussi l'esquisse
d'un "retour" au dialogue, à la parole. Le problème
qui va alors se poser dans la strophe III, c'est de conforter ce
dialogue en opérant une anamnèse vers le thème amoureux —
et, par là, une "résurrection" (au moins de la
personne) —, mais le renversement n'est-il pas largement
engagé dès cette strophe II ? Elle semble en effet
exploiter l'alternance (syllabique, vocalique) en liaison avec le
roulis et le virement pour suggérer le passage du sonore à son
envers, le passage de l'entendre au dire, de l'absence du NOUS au
TU.
3. Schéma des rimes, prosodie et
construction syntaxique :
Avant d'examiner si la fin du poème marque ou non une
rupture, arrêtons-nous un moment sur les rapports entre prosodie
et syntaxe pour souligner l’homogénéité des deux
premières strophes.
L'ariette est formée de trois sixains d'heptasyllabes, dont
les rimes s'organisent selon le schéma classique /aaBccB/,
où B seule est vocalique-masculine. La règle de
l'alternance est donc respectée et, si cette disposition donne
la supériorité numérique aux rimes féminines, elle consacre
également la valeur conclusive des rimes vocaliques.
Cette strophe n'est toutefois pas totalement régulière :
Martinon et Cornulier notamment, mettant ce sixain en rapport
étroit avec le quatrain croisé, y discernent une césure
médiane: aaB // ccB. Or cette dernière est totalement
absente, des deux premières strophes au moins : elles semblent
composées d'un distique de rimes plates, relativement individué
par la ponctuation et par le thème, puis d'un quatrain à
rimes embrassées, lui-même divisible par moitié. Le risque
d'éclatement (en aa / bccb) n'est donc pas négligeable.
Cependant, les rimes féminines assurent l'homogénéité : les
consonnes /r-z/ de langoureuse-amoureuse (aa)
reparaissent dans les rimes cc brises- grises. En
outre, brises assure une cohérence encore plus
large : grâce aux graphèmes "b-is", le bois
de la rime b, élément étranger au thème initial en
/r-z/, trouve sa place dans la prosodie du sixain. On constate le
même phénomène, mais comme atténué, dans la deuxième
strophe, où murmure-susurre et expire-vire ont
en commun le [r] final, autre allongeante, le tout pris comme
nous l'avons vu dans un jeu entre voyelles /i/, /y/ et /u/ —
les deux concernées ici étant de toute façon proches, du point
de vue phonologique comme de celui de l'articulation. Le poème
offre donc par deux fois un schéma proche de aaB a'a'B,
a' étant une dérivée problématique de a,
selon un rapport peut-être de plus en plus lâche.
La disposition des rimes semble liée, plus qu'à toute autre
chose, à la construction syntaxique. Dans la première strophe,
la division (a/a /bc/ cb) suit la distribution des C'est,
l'anaphore faisant des vers 3-4 et 5-6 des équivalents de chacun
des vers 1 et 2. Le fait que le groupe 3-4 se termine sur une
rime féminine, brises, proche des rimes a,
renforce cette impression de reprise et d'expansion. Mais ce
n'est plus le cas avec le dernier syntagme, qui se termine, lui,
sur la rime vocalique. Or cette inversion des rimes (Bc-cB)
coïncide avec une inversion grammaticale : à { C'EST + groupe
nominal avec complément déterminatif // + complément de lieu }
succède {C'EST, + complément de lieu,// + groupe nominal avec
complément déterminatif }. La rime suit donc la fonction
grammaticale et le retour tardif de la rime masculine coïncide
avec la venue retardée de l'expansion de C'EST. Symétrie et
résolution de l'attente : ainsi se construit une valeur
conclusive qui donne à la rime vocalique sa pleine importance,
et à VOIX sa force ultime.
En S. II, nous retrouvons globalement la même structure :
propositions d'un seul vers dans le "distique", de deux
vers dans le "quatrain", pour la plupart introduites
par des termes dérivés de l'anaphore initiale ; et, pour finir,
construction { TU DIRAIS, + complément de lieu,// + groupe
nominal avec complément déterminatif }, tout à fait analogue
à celle des vers 5-6. La valeur conclusive est sans doute la
même et cela confirme l'importance donnée à cailloux,
qui est ici à la place tenue par voix en S. I. Mais il
faut noter au moins une différence avec le premier sixain : le
parallélisme syntaxique/ prosodique est brouillé par la
ponctuation. Le point d'exclamation à la fin du vers 7 et les
points de suspension à la fin du vers 10 tendent à isoler les
vers 8-9-10, c'est-à-dire les trois vers successifs qui tournent
sur trois rimes différentes (abc : susurre / doux /
expire) et qui sont par ailleurs soudés par les deux CELA
en anaphore. Quelle valeur peut avoir cette insistance sur la
diversité, avant le retour (aux vers 11-12) à une construction
déjà connue, et résolvant toutes les attentes de rimes ? Ne pourrait-on la mettre en rapport avec
l'échec des tentatives de définition ? Momentanément,
l'instabilité et l'incertitude prévalent — y
compris pour ce qui est du jeu des voyelles.
On perçoit ici le schéma, non comme un donné qui
prédéterminerait la syntaxe, mais comme une forme réservant la
place d'une prosodie globale susceptible de la réinterpréter.
A priori, on ne retrouve dans le troisième sixain ni la forte subordination
du schéma de rimes à la syntaxe, ni l'apparentement phonétique de rimes distinctes.
Comme dans beaucoup des Ariettes, cette dernière strophe n'est faite
que d'une seule phrase — est une strophe-phrase — et l'anaphore déjà
affaiblie a disparu. Si le C'EST revient, il a changé de statut et n'est plus
appelé que par la construction segmentée (7).
La distribution des deux points d'interrogation conduirait même, selon une analyse
strictement "ponctuométrique", à retrouver le schéma classique aab
ccb. Pourtant, le découpage de la phrase semble obéir grosso modo
au même schéma que dans les strophes précédentes :
Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante,//
C'est la nôtre,n'est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,//
Dont s'exhale l'humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas ?
|
La seule difficulté, mais elle est la même avec une césure
médiane, tient à la construction de la relative finale :
l'antécédent de DONT est-il la tienne ou la nôtre
? La première de ces lectures aboutirait à faire du moi un
veuf, ce qui n'est pas inconcevable compte tenu de la thématique
verlainienne de la voix (cf. chapitre sur le titre),
mais antienne deviendrait alors incompréhensible. Nous
considérerons donc le vers 16 comme une incise, ce qui rend plus
plausible une lecture aa bccb. Dès lors, nous serons
contraint de rechercher, comme dans les sixains précédents, une
relation entre les rimes a et c, sans
pour autant nier l'esquisse de division binaire que suggèrent
les points d'interrogation. Restera à interpréter cette
superposition de structures.
Enfin, à ces liens internes aux sixains, il faut en ajouter
d'autres, entre strophes. Tout d'abord un lien entre les rimes aa,
par aMouReuse-MuRMuRe-doRMante, dans le cadre d'une
chaîne en [Rm] qui assure une part de la cohésion de l'ariette,
surtout avec l'écho ramures-murmure. Mais,
précisément, ce sont moins les rimes qui sont ici en cause
qu'une prosodie globale du poème, et nous renvoyons donc cette
question à l'étude générale de la prosodie. Ensuite, un lien
entre les rimes c, par le [i] ou, plus exactement, par le
renversement de [Ri] à [iR] : brises -grises / expire-vire
: si on rapproche cette relation du couple aMouReuse-MuRMuRe,
on a peut-être la confirmation d'une homothétie entre les deux
sixains.
Quant au dernier, il serait plus lâchement relié aux autres
sans sa fin, qui entre dans ce système "vertical" :
ses rimes vocaliques (n'est-ce) pas-bas font en
effet écho à celles de S. I, bois-voix. Par ce moyen,
ce qui n'est malgré tout qu'une assonance — /a/ n'a jamais rimé avec /wa/ — devient l'instrument d'une
cohésion supérieure, de bois à bas, en
fermant le poème. La liaison se faisant logiquement par la
dernière rime-écho.
4. La dernière strophe : la
réversibilité :
On a vu dans cette strophe l'explication des deux
précédentes et un moment de réflexion qui ferait la preuve que
l'amour demeurait derrière le bruissement. Nous insisterons
plutôt sur de nouveaux déplacements et même sur une
instabilité qui rend le thème indécidable.
Cette âme qui
se lamente //
En cette plainte
dormante
Tout comme Sagesse III,9 qui
joue, explicitement, sur le mot air et qui finit aussi sur
l'évocation d'un soir :
-
- Le son du cor
s'afflige vers les bois
- D'une douleur
on veut croire orpheline
- Qui vient
MOURIR au bas de la colline...
- L'âme du loup
PLEURE dans cette voix (...)
- D'une AGONIE
on veut croire câline...
- Pour mieux
faire cette PLAINTE ASSOUPIE
- La neige
tombe...
- Et
l'air a l'air d'être un SOUPIR
d'automne,
- Tant il fait
doux par ce soir monotone
- Où SE DORLOTE
un paysage lent.
|
les vers 13-14 tentent de remonter en deçà de la mort pour
substituer à celle-ci le sommeil et l’enfance. Cette
âme qui se lamente commence du côté des fantômes, des
morts mal ensevelis, des âmes en peine. Puis plainte
dormante rappelle le cri doux, c'est-à-dire
l'agonie, mais en éteignant le mouvement qui culminait avec agitée
et roulis — d'où dormante, si proche d'assoupie.
Surtout, comme Le son du cor, l'ariette met l'âme
dans la plainte :
-
- L'âme du loup
pleure dans cette voix
-
- Cette âme qui
se lamente
- En cette
plainte dormante...
|
Ici, c'est LAMENTE qui réalise l'inclusion : /am/~/lamãt/, faisant ce que dit en.
Toutefois, loin de condenser et de (re)définir, les
démonstratifs se transforment ici en instruments d'une
indécision. En effet, ils tirent de ce qui précède deux
"thèmes" : cette âme, cette plainte,
alors qu'on attendrait un seul terme (soit "L'âme qui se
lamente dans cette plainte", soit "Cette âme
qui se lamente en une plainte"). Une de ces équivalences
semble de trop et on peut a priori penser que c'est la
seconde, tant l'autre paraît mieux convenir au thème sonore de
S. II. Résignons-nous cependant à ce dédoublement : on dirait
qu'il tend à revenir sur l'extase pour tenir ensemble les deux
motifs initiaux — psychologie et paysage —, comme si
l'un n'était plus solidaire de l'effacement de l'autre, comme si
s'installait la réversibilité, pour ne pas dire la
concurrence.
Cependant le retour à l'âme apparaît bien compromis. Cette fois, ce sont les
voyelles nasales qui opèrent, se diffusant autour de la préposition. L'inclusion
d'âme dans lamente, le passage de /a/
à /ã/, le fait que pLaiNTE dorMANTE reprenne les sonorités et la signification
de LaMENTE, tout cela tend à ramener avec force le sonore (8).
L'anamnèse n'était-elle qu'un piège, qui relance l'extase ?
C'est la nôtre, n'est-ce pas ?
// La
mienne, dis, et la tienne
Pourtant, le vers 15 : C'est la nôtre, n'est-ce pas ?,
revient à âme, passant par-dessus ces équivoques —
comme si le poème proposait enfin une lecture définitive de ce
qui n'a cessé de faire énigme, en reprenant le C'EST du début
et en réinstallant la thématique amoureuse. Mais cet essai de
"bouclage" du poème échoue : le Verlaine
syntaxier, décidément tenté par la rature, choisit de placer
le phatique n'est-ce pas ? juste après c'est.
Les deux formes (peu importe leur statut sémantique-énonciatif
différent, la similitude comme la construction du vers les
affrontent) tendent à coaguler et l'affirmation initiale y perd
beaucoup de sa consistance.
Le doute jeté sur l'affirmation de cette âme duelle va se
fortifier au vers suivant, qui répète le dédoublement noté
aux vers 13-14 : La mienne, dis, et la tienne. On
pourrait certes justifier une telle apposition en soutenant
qu'elle ne nie pas nécessairement l'existence d'une âme unique,
appartenant à la fois à deux personnes, mais dis,
qui presse encore une fois l'autre de rassurer et de confirmer,
divise nettement (matériellement, pour ainsi dire) le couple,
tout comme n'est-ce pas ? allait à l'encontre de c'est.
Etrange vocation de ces phatiques à travailler à contre-courant
de l'énoncé, à le miner. Le dialogue ne s'instaure ici que
sous la forme d'une exigence insatisfaite : l'autre ne répond
pas, ce n'est qu'un interlocuteur muet faisant attendre son
acquiescement et responsable à cause de cela du ton interrogatif
qui affecte toute la phrase.
Il faut aussi parler de la prosodie. Après la nasalisation
des vers 13-14 apparaissent les premiers, les seuls [n] du
poème. Dans C'est la nôtre, n'est-ce pas ?,
la négation et le nous sont associés de façon
révélatrice. Puis LA Mienne
fait écho à (cette âme qui se) LAMente,
mais avec une sorte de dénasalisation, graphique plus que
phonématique : les /ã/ et /ê/ de lamENte, plAINte
et dormANte sont remplacés par des /jen/ ou "-ienne". La relation entre
les rimes consonantiques de cette strophe, apparemment nulle, est
donc en réalité aussi rigoureuse que dans les deux premiers
sixains, encore que plus lointaine.
Dont s'exhale l'humble antienne
Faut-il lire dans ce jeu un "succès" de l'âme, un moment menacée
à travers la nasalisation ? On pourrait plutôt interpréter cette relation
comme l'indice d'une solidarité entre deux thèmes, celui de la plainte et celui
du couple — solidarité que va manifester entre tous les signifiants le
mot antienne qui, au vers 17, se constitue de l'association des deux
chaînes ANTE + TIENNE et qui, pour le sens, suggère l'alternance de deux voix
répétant un même texte. Les deux ne font plus qu'un et nous avons ici l'équivalent
duel de ce qu'était chœur à la fin de S. I pour les petites
voix (9). Notons aussi
que le dis passe partiellement dans les /tj/ de la tienne / antienne,
comme pour donner un écho, tout de même, au dialogue.
ANTIENNE soude donc couple et son, mais cela grâce à une sorte d'inversion
du mouvement. Dans la prosodie d'abord : Dont s'exhale l'humble antienne
fait écho au début du sixain, ... qui se lamente // En cette plainte dormante,
mais la comparaison fait surtout apparaître des inversions : /kis¤la/~/segzal/
; /plêt/~/ûbl/ ; /lamãt/, /dòRmãt/~/ãtjen/ (ici, il s'agit plutôt d'un déplacement par rapport
à l'accent). Dans la chaîne des [l], qui réunit d'abord Lamente, LA mienne,
LA tienne et PLAINte, le vers 17 renverse les échos avec s'exHALE L'HUMBLE, rebond de consonnes. Or,
du point de vue sémantique, dont s'exhale constitue aussi une espèce
de point de rebroussement. Par comparaison avec en cette
plainte qui enfermait l'âme dans le son, cet avant-dernier vers fait sortir
le son de l'âme. La plainte, d'enveloppe (corps ?) de l'âme, en devient l'émanation.
Le choix même du relatif DONT qui (même s'il n'est pas D'OÙ) concilie et dépasse
les constructions en QUI et en DE utilisées jusqu'ici pour déterminer les substantifs,
affirme le rôle de l'âme comme source du bruissement, la mettant à la place
de tous les éléments naturels précédemment cités : moment d'achèvement de la
syntaxe et de "reconquête" psychologique ? Mais nous restons dans
la même phrase qui enfermait l'âme dans la plainte : on a le sentiment
que l'escarpolette (10) des CETTE, qui ne
concernait que le thème, s'étend maintenant aux rapports entre le moi et la
nature. Il y a refus de choisir, ou condamnation au vire-vire.
Mentionnons aussi la relation entre la
préposition EN et le préfixe EX-, de retour avec S'EXHALE. Nous
retrouverons assez souvent de ces pronominaux dans le recueil, à
des emplacements privilégiés. A propos, encore, de Sagesse
III,9, où ils jouent un rôle déterminant
(s'afflige, se dorlote) de concert avec les verbes
intransitifs ou employés intransitivement, F. Deloffre [Stylistique
et poétique françaises, SEDES, 1970, page 174] discerne
une "intention de noter des états purement affectifs,
"subjectifs" (...), c'est-à-dire ne visant aucun objet
extérieur ; cet effet est particulièrement net dans le cas des
deux formes pronominales, dont l'une ouvre et l'autre ferme le
poème." Selon lui, la troisième personne du singulier et
l'impersonnel "météorologique" contribuent à donner
au paysage "une sorte d'existence autonome,
dépersonnalisée, très différente de celle du paysage
romantique traditionnel" et la remarque pourrait s'appliquer
à ces pronominaux. Mais l'autre particularité de ces verbes est
de former, à deux, une opposition de type symétrique : s'ennuie
/ s'écoeure (Ariette III) ou s'ensanglante /
s'effacent (Simples fresques I). Ici, aux vers 13 et
17, réglant les rapports entre l'âme et le sonore, se constitue
un couple SE lamente EN, DONT S'Exhale. La
même âme est à la fois ce qui se coule dans le sonore et ce
dont celui-ci s'extrait. Bue par la plainte, elle libère ensuite
(ou en même temps ?) l'antienne. Le dedans est aussi le dehors,
selon une logique que nous retrouverons à l'oeuvre ailleurs dans
les Ariettes et qui fait irrésistiblement penser à
l'anneau de Möbius.
Par ce tiède soir, tout bas.
Dans le dernier vers, en même temps qu'il referme le poème
puisqu'il reprend la rime bois-voix de S. I (et même
fait écho à tous les frissons des bois),
TOUT BAS confirme le mouvement de descente si net en S. II.
Préparé par humble, ce syntagme final peut en effet
s'interpréter en deux sens : le sens sonore,
"évident" (ce serait un adverbe portant sur S'EXHALE
et retardé jusqu'à la fin de la relative, comme pour insister/
boucler), mais aussi le sens spatial : "contre terre",
sinon "sous l'eau". Cette ambivalence nous
paraît consubstantielle au poème, dans la mesure où
l'affaiblissement du murmure y est décrit comme une descente
jusque sous l'eau. Nous verrons que, du même coup, l'adverbe
contribue à "vectoriser" le recueil, en liaison avec
d'autres desinit (noyées,
haut la tête). Il était en outre préparé par l'épigraphe.
Quant à Par ce tiède soir, il semble donner au
paysage une revanche d'autant plus marquée qu'il rappelle ces
clausules qui rassemblent ou résument des éléments jusque là
épars. Le CE subsume à nouveau, comme s'il effaçait les deux
démonstratifs concurrents qui précèdent (cette âme, cette
plainte) au bénéfice de l'unicité, comme si l'ariette
n'avait été que la description d'un moment du paysage, comme si
la nature retrouvait la prééminence.
Il y a donc deux logiques concurrentes, apparemment : l'une,
paradigmatique, mais aussi de l'ordre de la phrase (enfin)
unique, où les démonstratifs mettent SOIR en relation avec AME
et PLAINTE et qui projette les uns sur les autres les thèmes du
bruit, de la nature et de l'amour, avec une forte connotation de
/mort/. SOIR y fait écho à SUSURRE, et à SOURD qui occupe la
même position au dernier vers de la strophe précédente. En
particulier, les deux thèmes de l'amour et du paysage, qui
étaient en relation de substitution en S. I, coexistent enfin
dans une sorte d'espace narratif minimal. Mais il y a aussi une
logique strictement syntagmatique, celle qui donne le dernier mot
au paysage dans lequel l'antienne se diffuse.
Cependant, la préposition PAR permet peut-être de concilier
les deux perspectives : rattachée à S'EXHALE, elle
suggère que le SOIR pourrait n'être que la bouche de l'âme,
par où se libère l'antienne. Celle-ci ne se transfuserait donc
pas de l'âme dans le soir, parce que le paysage serait le
langage de l'âme. On conçoit alors comment SOIR, aussi
ambivalent que TOUT BAS, peut être en relation avec AME, PLAINTE
(par les démonstratifs), SOURD et SUSURRE (par la prosodie).
La construction du dernier vers en deux parties — l'une
tenue par sa fermeture prosodique : pAR
CE tièdE SOIR
(/-aRs¤...¤swaR/) ; l'autre dont la brièveté, comme conçue
pour signifier la restriction, semble déséquilibrer le vers
— se justifie donc par la volonté de projeter le sonore et
le paysage l'un sur l'autre, l'un contre l'autre.
Il y a toutefois quelque abus à parler encore de paysage,
dans la mesure où celui-ci se réduit à l'atmosphère, comme y
insiste l'adjectif. Peut-être à opposer à FRAIS comme DORMANTE
l'était à AGITÉE (où l'actif se trouvait paradoxalement du
côté du non-mouvement), TIÈDE fait écho à (AN)TIENNE, mais
en poursuivant la dénasalisation jusqu'à son terme : il
remplace le [n] par la consonne orale correspondante, [d]. Cette
différence ne peut se comprendre que par référence au
paradigme en [n], très localisé dans la dernière strophe, et
notamment par rapport à NÔTRE-MIENNE-TIENNE : TIÈDE semble
alors consacrer la disparition du couple, alors qu'ANTIENNE le
maintenait, y compris dans le sens obvie.
En tout état de cause, la tentative de restaurer la personne
et le dialogue n'a pas abouti. Ne reste plus que l'équivoque
entre paysage et murmure, ou plutôt entre espace et son :
l'air même, c'est-à-dire la romance sans paroles. D'une
certaine façon, c'est la leçon que la prosodie n'a cessé de
proclamer, associant à tout élément du paysage un élément
sonore : ramures-murmure, bois-tout bas,
gazouille-cailloux. Mais résumer le poème à ces
échos serait accepter la vulgate qui étend à toute l'ariette
un prétendu mimétisme. Ce serait oublier le glissement vers le
bas, qui nous a conduits au-delà de la mort, et l'échec d'une
tentative de "re-personnalisation". A deux reprises et
de deux façons différentes, le couple aura été effacé par le
paysage mais, à la fin, c'est par une nature vide, réduite à
l'atmosphère : "air", espace-son où BAS et SOIR, de
même que la rime NE... PAS-BAS, affirment la proximité d'une
extinction. Le passage par le négatif reste essentiel et fonde
un usage de la dualité sans issue propre aux Ariettes :
le battement du deux est renvoi incessant de l'un à l'autre,
indécision, réversibilité, sinon contradiction insoluble.
Retour à AUTOUR DU TITRE ; les
trois phases d'une ariette
NOTES
(1)
Les phatiques ont pour fonction "d'assurer ou de maintenir
le contact entre le locuteur et le destinataire" (J. DUBOIS
et al., Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1973).
Cf. aussi R. JAKOBSON, Essais de linguistique générale,
Ed. de Minuit, 1963, page 217.
(2)
Le même dictionnaire de Dubois définit les présentatifs comme
"des mots ou expressions qui servent à désigner quelqu'un
ou quelque chose pour le mettre en rapport avec la
situation".
(3)
Claude CUENOT (Le style de Verlaine, CDU, 1963, page
107, note 137) considère que le mot garde un halo religieux et
le met en rapport avec antienne, terme liturgique (vers
17). Nous allons plutôt constater que Verlaine prend ici le
contre-pied de la défintion donnée par Littré (la caution
n'est pas mystique, certes !) : "Elévation
extraordinaire de l'esprit, dans la contemplation des choses
divines, qui détache une personne des objets sensibles
jusqu'à rompre la communication de ses sens avec ce qui
l'entoure".
(4)
FATIGUE apparaît toujours dans les Romances sans paroles,
comme dans La Bonne Chanson XIV, dans un contexte
fortement érotisé. François-les bas-bleus (Ariette
VI), qui est voué à n'être que spectateur de l'amour,
n'est, lui, "jamais fatigué"... D'autre part, à
propos de l'extase langoureuse, on peut se
demander si le desserrement des consonnes (/l-kst---l-g-r-z/),
accompagné de passages de la sourde à la sonore, ne fait pas
pour partie la valeur de langueur.
(5) A
quoi s'ajoute un hiatus licite, "agitée^expire".
"Quand un mot se termine par un e muet, précédé
lui-même d'une voyelle, et qu'on élide cet e muet, il
reste effectivement un hiatus, qui est toutefois admis dans la
versification", explique Quicherat (Traité de
versification française, Hachette, 1850, page 53), tout en
recommandant d'éviter le contact de consonances identiques - ce
dont Verlaine n'est pas loin ici.
(6)
Encore Cuénot, toujours prisonnier du mythe des "sensations
ténues" (Ibid., page 169).
(7)
Le démonstratif cesse ici d'appartenir à un présentatif pour
devenir "représentatif", anaphorique - au sens
grammatical du terme.
(8)
Un sonore bien proche du fin refrain incertain de l'Ariette
V, dont les rimes privilégient aussi à ce moment la
voyelle nasale, contre le /e/.
(9)
L'antienne est un "chant qu'on exécutait autrefois à deux choeurs
qui alternaient" (Littré) - ou plutôt à deux demi-choeurs
(et après la communion). A des versets d'un psaume succédait un
répons toujours identique, et donc proche d'un refrain. Mais on
peut se demander si ne joue pas, en sus ou surtout, le souvenir
de l'expression "une triste antienne", en relation avec
"plainte" et "se lamente".
(10)
Comme choeur (qui recouvrait peut-être
"coeur", selon la logique de l'extase) annonçait le
thème de la strophe II, roulis marque peut-être celui
de la III, en même place : dans le vers qui la précède.
Page d'accueil
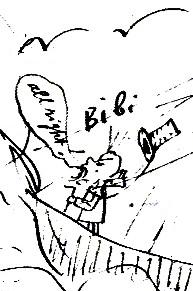 Le poème parut d'abord dans la Renaissance
littéraire et artistique du 18 mai 1872 sous le titre de Romance sans
parole. De fait, cette Ariette semble se résumer dans ces trois
mots : on oublie bientôt les premiers vers pour se laisser séduire par l'évocation
d'un bruissement multiple. La Romance sans paroles, ne serait-ce que
le paysage murmurant, métaphore ou écho de l'amour qui vient de s'accomplir
?
Le poème parut d'abord dans la Renaissance
littéraire et artistique du 18 mai 1872 sous le titre de Romance sans
parole. De fait, cette Ariette semble se résumer dans ces trois
mots : on oublie bientôt les premiers vers pour se laisser séduire par l'évocation
d'un bruissement multiple. La Romance sans paroles, ne serait-ce que
le paysage murmurant, métaphore ou écho de l'amour qui vient de s'accomplir
?