II. QUE VERLAINE COMPOSE
Page d'accueil
"Verlaine a (...)
construit savamment son recueil et chacune des parties qui le
composent. (...) Aussi ne puis-je comprendre pourquoi certains
critiques ont poussé de hauts cris quand j'ai suggéré, il y a
bien longtemps, que les Romances sans paroles avaient
peut-être une " architecture secrète " pour
emprunter l'expression de Baudelaire qui, lui aussi, avait voulu
donner une forme non seulement à ses poèmes mais au recueil qui
les réunissait." [E.
Zimmermann, "Variété de Verlaine", 1982, page 9 ;
voir, de la même, Magies, page 57, et 1965, pages
259-281].
Il est simplement dommage que, se proposant de rendre compte
de cette architecture par un jeu de tensions ("entre la
douceur et la violence, l'espoir et le désespoir, le désir de
s'abîmer dans la mort et de vivre, entre ce que le poète
ressentait comme le passé et ce qu'il voyait comme
l'avenir"), Eleonore Zimmermann ait aussitôt fait appel au
symbole de l'escarpolette et baptisé les "principes de ces
tensions Mathilde et Rimbaud". Même si "ce ne sont pas
les noms, ce sont les oppositions qui comptent", on
retombait alors dans le biographique du coeur écartelé, de
l'éternel balancement. Avec d'inévitables et bien
embarrassantes querelles d'attribution : tel poème est-il à
rapporter à l'un ou à l'autre amour ? La comparaison avec une
tentative similaire de G. Zayed [1975, pages 7-50],
qui remplace souvent Rimbaud par Elisa, révèle à tout le moins
des incertitudes : y aurait-il finalement si peu de battement entre
les poèmes ?
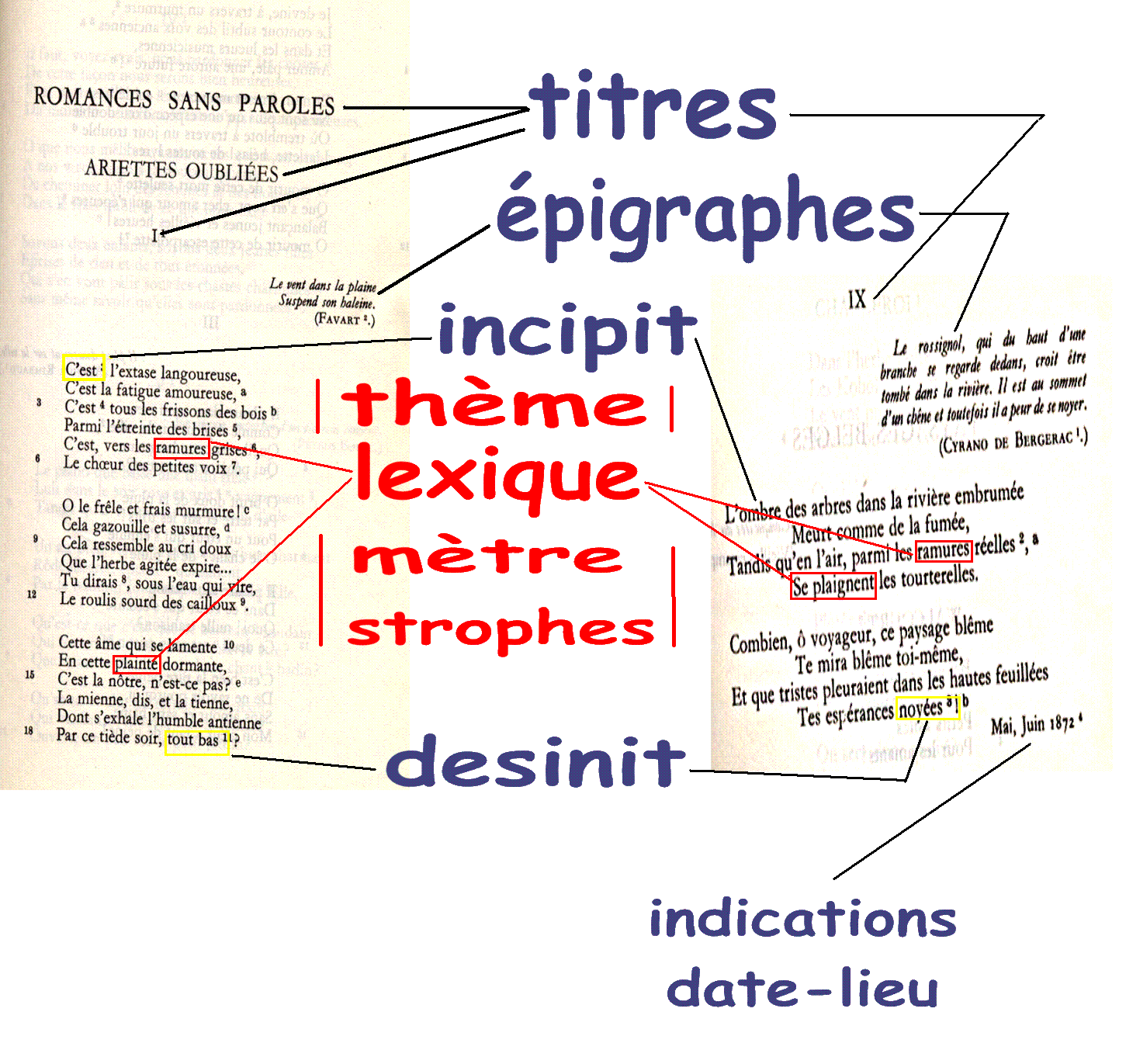 Nous préférons partir de l'organisation textuelle,
des éléments qui, du recueil, forment un livre : titres, épigraphes
et autres indications annexes, incipit et desinit,
récurrences de mètres, de schémas de rimes, de mots. A tout cela, nous ajouterons
un motif qui s'est déjà signalé à notre attention dans les Ariettes
extrêmes : celui de l'eau, de l'arbre
et de l'oiseau. Tous ces éléments, soit internes-externes, soit récurrents,
constituent une palette pour la mise en interaction des poèmes, en liaison avec
le découpage obvie et avec les positions fortes que celui-ci détermine. Chacun
obéissant à sa logique propre, nous les avons passés successivement en revue.
Les convergences qui importent nous semblent être celles qui se décident d'organisation
à organisation, s'il y a vraiment composition. Nous avons donc essayé de ne
pas superposer hâtivement les niveaux et d'attendre plutôt des indices de "coalescence".
Nous préférons partir de l'organisation textuelle,
des éléments qui, du recueil, forment un livre : titres, épigraphes
et autres indications annexes, incipit et desinit,
récurrences de mètres, de schémas de rimes, de mots. A tout cela, nous ajouterons
un motif qui s'est déjà signalé à notre attention dans les Ariettes
extrêmes : celui de l'eau, de l'arbre
et de l'oiseau. Tous ces éléments, soit internes-externes, soit récurrents,
constituent une palette pour la mise en interaction des poèmes, en liaison avec
le découpage obvie et avec les positions fortes que celui-ci détermine. Chacun
obéissant à sa logique propre, nous les avons passés successivement en revue.
Les convergences qui importent nous semblent être celles qui se décident d'organisation
à organisation, s'il y a vraiment composition. Nous avons donc essayé de ne
pas superposer hâtivement les niveaux et d'attendre plutôt des indices de "coalescence".
POLARITÉS, VECTORISATION et
REVERSIBILITE
De ces neuf analyses, il ressort que les Romances sans
paroles se composent de façon multiple : se pose dès lors
le problème de savoir si l'on doit chercher à articuler ces
différentes organisations et, si oui, comment.
1. Nous ne reviendrons que brièvement sur ce qui confirme l'identité des sections. Il s'agit pour
l'essentiel des titres, avec leurs
trois séries bien différenciées, et des indications de temps et de lieu, dont
chaque partie fait un usage propre. On peut y ajouter les épigraphes, dont la valeur n'est pas
la même dans les Ariettes oubliées et dans les Paysages belges,
puis qui disparaissent avec les Aquarelles [la relève étant prise par les titres pour ce qui est du dialogue avec
les poèmes ?], et, bien entendu, les récurrences lexicales — non seulement
les termes propres à chaque section, car ils peuvent ne résulter que d'une opération
de découpage, mais avant tout ceux qui changent de valeur d'une section à une
autre. Cette dernière segmentation pourrait d'ailleurs être rapprochée de celle
des mètres complexes
: (x)+6 des Ariettes, (non-5)+5 des Paysages belges, 5+5 de
Birds, 6+6 des Aquarelles.
A ces phénomènes de différenciation, il faut joindre ceux de délimitation.
La démarcation la plus nette est due aux desinit
(plus précisément à la distribution des finales vocaliques et consonantiques),
mais on pourrait aussi mentionner le rôle des contrepoints métriques (le
pentasyllabe dans Ariettes oubliées et Aquarelles), en rapport
avec la distribution des heptasyllabes et des alexandrins.
Enfin, la forte structuration des Paysages belges,
à la fois par les incipit (Malines récrivant
les poèmes précédents) et par les desinit, la prosodie
des titres et le nombre
de strophes (organisation concentrique), aboutit au moins en première analyse
à diviser en trois le recueil, en isolant les deux autres sections.
2. Or, celles-ci — Ariettes oubliées et Aquarelles
— sont en relation étroite, en premier lieu par leurs
titres, qui évoquent respectivement l'air et l'eau, deux
éléments que le motif de l'arbre à l'oiseau des Ariettes I et IX
a révélés, contraignant à ce jeu étymologique. Ensuite, ce même motif
de l'oiseau qui, de la noyade suggérée ou dite dans les poèmes-cadre
de la première section, se métamorphose à la fin de la dernière en marche
sur les eaux. Du coup, les desinit extrêmes des Ariettes
oubliées, "tout bas" et "noyées", entrent en dialogue
avec le desinit de Beams, "portait haut la tête".
Les premières Ariettes et les dernières Aquarelles s'opposent
également par leurs incipit
: formes d'impersonnalisation versus retour des pronoms personnels,
selon des modalités plus complexes qu'il n'y paraît. Enfin, nous ne saurions
trop insister sur le jeu corrélé de l'heptasyllabe et de l'alexandrin.
Tout cela, ensemble et en excluant des éléments plus
incertains, esquisse surtout une polarité —
opposition, solidarité et pouvoir de structurer — entre
début et fin du recueil. Nous n'avons plus affaire à
un découpage en séquences "égales", à une
segmentation, mais bien à un JEU de POSITIONS corrélées, ce
qui signifie que rien ne peut en être considéré isolément,
indépendamment du tout que forme le recueil grâce à elles.
Ces positions, frontières de poèmes ou de sections, parfois
même quasi extérieures (le "paratexte") sont avant
tout les extrêmes, le cadre : extrémités des poèmes extrêmes
des sections extrêmes.
| "bas" versus "haut (la tête)" |
Ariette I versus Beams
|
| heptasyllabe versus alexandrin |
Ariettes
I et IX
vs Green et
Beams
|
| noyade versus marche sur les eaux |
Ariettes
I et IX versus Beams
|
| air versus eau |
"Ariettes"
versus "Aquarelles"
|
3. Examinant la distribution des mots les plus fréquents, et leur
changement de valeur ou d'acception, nous nous sommes demandé si le recueil
ne se divisait pas entre deux "versants" dont
les Simples fresques feraient le départ : l'association impair-rimes
féminines, se défaisant là, paraît confirmer cette bipartition. Cette troisième
organisation n'est pas contradictoire avec la deuxième et pourrait même articuler
polarisation des extrêmes et structuration concentrique des Paysages belges.
Dès lors, il pourrait n'y avoir en fait que deux compositions
: la division obvie en sections et, prenant appui sur les bornes
de celles-ci, une opposition entre deux parties, organisant assez
fortement les "extrêmes" et plus lâchement le reste,
à l'exception des "bornes" centrales (Simples
fresques). Reste à préciser le statut de cette
organisation seconde.
* *
a- une seconde articulation :
Cette composition est loin de concerner l'ensemble des poèmes
: en particulier, elle n'a pour ainsi dire pas prise sur ce qui
fait l'unité ou la spécificité de chaque section :
- pour les Ariettes, les variations sur le thème du
"deux" — du couple, du double, du
duel —, menant à des formes diverses de
réversibilité ;
- pour les Paysages belges, le thème du voyage et, plus
précisément, de l'expulsion par le paysage ;
- pour les Aquarelles, la régression amoureuse.
Si nous avons avancé le terme de polarité, c'est
d'abord parce que nous avons affaire à une structuration à
partir des "bornes", des extrémités en opposition.
Même dans les Paysages belges, les deux desinit dont la
relation s'impose avec le plus de force sont certainement le
premier et le dernier : "juifs-errants"
versus "Fénelon"
— comme dans les Ariettes. Et, dans celles-ci, nous
n'avons guère trouvé de positions pertinentes (au moins en
premier ressort) que dans les deux poèmes-cadre. C'est
peut-être d'ailleurs le propre de la composition que d'investir
certains points du texte seulement : la même remarque vaut en
effet pour les Aquarelles, le desinit de Beams
ne renvoyant guère qu'à ceux de Birds et de Green.
De surcroît, dans l'Ariette IX par exemple, la
composition ne retient d'abord de la contradiction finale entre
"hautes feuillées" et "noyées" que le
dernier terme, en rapport avec le desinit de l'Ariette I
et avec le participe du titre.
Tout indiquerait donc que la composition s'appuie sur des
éléments comme détachés, rendus indépendants du poème ou
lui échappant provisoirement pour construire le livre. Le cas le
plus frappant est peut-être celui des contrepoints, dont le
rôle semble être purement structurel. On pourrait parler de remploi
ou, mieux peut-être, de seconde articulation, qui serait le
se-faire-livre des poèmes. Devenant positions, ces
éléments cesseraient de dire quelque chose des poèmes, pour
devenir ce que les poèmes disent du recueil. On comprendrait
mieux alors la non-pertinence des schémas strophiques,
travaillés par chaque pièce, et l'extrême pertinence du
mètre, résultant d'un choix "externe" et ne
participant pas à la construction du sens dans le poème.
Ce qui n'entraîne pas que la composition soit insignifiante :
simplement, elle ne contribue au sens qu'en tant qu'elle met les
poèmes (ou tel ou tel de ses éléments) en interaction. C'est
par exemple ce qui produit la polysémie de "tout bas" (Ariette
IX) ou d'"air" (Simples fresques I), ce
qui autorise à lier l'alexandrin et l'heptasyllabe de l'Ariette
IX à l'opposition "hautes
feuillées"/"noyées"...
b- une organisation complexe,
hiérarchisée, voire inventive :
La composition ne se limite toutefois pas aux extrêmes, même
si elle en part : elle modèle au moins en partie l'espace
intermédiaire, par extension — et en désignant souvent
encore des "frontières". Ainsi Beams renvoie
récursivement à Malines, par "glisser", à Green,
par l'alexandrin et le desinit, à Birds in the night,
par le desinit et le thème du naufrage... On ne peut donc
assimiler cette organisation à une structure pré-imposée par
le découpage obvie : toutes les positions ne sont pas données a
priori, en vertu d'une rhétorique des sections, des
commencements et des fins — à l'exception du commencement
et de la fin absolus. Il y a des renvois, peut-être
entrecroisés et quasi indéfinis, mais hiérarchisés. Surtout,
le motif et le mètre nous ont amené à identifier une position
forte à laquelle nous ne pouvions songer au départ : celle
qu'occupe Simples fresques I, à peu près au centre des
Paysages belges mais encore du côté des Ariettes.
La place du pentasyllabe dans cette même section — au
centre, et non plus en contrepoint au dernier poème comme dans
les Ariettes et les Aquarelles —, est de
nature à accentuer cette division de la section centrale dont on
a retrouvé trace ailleurs, sous la forme d'une symétrie
concurrençant l'organisation "cumulative".
En l'espèce, le recueil construit, invente la position : à
aucun moment nous ne pouvons isoler ce qui compose de ce qui se
compose, nous ne saisissons que du livre en train de se faire.
D'autre part, le rôle d'un élément dans la composition peut
être variable. Ainsi le mètre complexe de Birds
continue celui des Paysages belges, en x + 5, mais rompt
avec lui parce que binaire ; pour les titres, le même poème
commence la série de l'anglais mais, s'il tient par là aux Aquarelles,
il s'oppose à Beams comme la nuit au plein soleil ;
c'est en outre le "réservoir" biographique à partir
duquel va être menée l'entreprise palinodique de la dernière
section, tandis que l'évocation du naufrage sert de pivot entre
le motif de la noyade et celui de la marche sur les eaux. Quant
aux Paysages belges, ils se structurent à la fois de
façon autonome (par les titres et les incipit) et en fonction de
leur place centrale dans le recueil. En bref, la composition ne
cesse de réorganiser les éléments selon l'aspect sous lequel
on l'envisage : seuls le début et le terme absolus concordent à
peu près, cela va de soi — mais le mètre ne peut
coïncider tout à fait avec le motif, par exemple : la
construction des oppositions, passant par des moyens différents,
attribue parfois des valeurs différentes aux mêmes positions,
ou situe en des endroits différents les points d'articulation.
En ce sens, il n'y a d'autre totalité, d'autre structure globale
que le recueil, le livre — qui est l'effet et la raison.
c- des oppositions :
"Polarité" signifie donc que la valeur des
éléments relevés est toujours relative. La composition n'est
pas une simple organisation spatiale, une distribution figée des
places, une géométrie du recueil. Pour les incipit et desinit,
le jeu des extrêmes peut à la rigueur suffire pour décrypter
les oppositions, encore qu'aide aussi le fait qu'ils soient pris
dans les poèmes, qu'on commence à lire par eux. Mais il en va
autrement du mètre : on ne peut opposer l'heptasyllabe à
l'alexandrin en vertu de leur seule distribution, il faut aussi
s'appuyer sur le contraste qu'organise l'Ariette IX et
qui établit la solidarité des deux termes en en
"dialectisant" les rapports, sur le fond d'ailleurs
d'un certain nombre d'exclusions et de variations réglées. En
effet, quand on a lu en tout et pour tout l'Ariette I et
Beams, on ne sait pas encore que les mètres tendent
vers l'alexandrin : il faut au moins constater, de surcroît,
l'utilisation faite de toutes les variantes du mètre complexe,
selon un certain ordre. Quant au lien supposé entre les titres Ariettes
et Aquarelles, il ne prend consistance que de
reproduire, sur le mode de l'opposition "encadrante",
la dérive constatée dans la première ariette. C'est d'ailleurs
ce qui nous a conduit à proposer les termes de "valeur
incipitive" (pour Ariettes et pour Romances
sans paroles) et de "valeur conclusive" (pour Aquarelles).
Autrement dit : la composition ne se fonde sur des oppositions
qu'en tant que chaque terme de celles-ci appelle ou rappelle son
pendant — mais aussi en tant qu'elles participent du
fonctionnement des poèmes, probablement.
d- y a-t-il vectorisation ?
Il est exclu de rabattre les termes les uns sur les autres,
d'assimiler en quelque sorte air, heptasyllabe et glissement vers
le bas, d'un côté ; eau, alexandrin et surrection-contention de
l'autre, en ignorant le mouvement du recueil. Il est clair, en
particulier, que l'alexandrin n'est pas lié à un contenu
thématique déterminé — ainsi Green diffère
notablement de Beams. Simplement, avec l'heptasyllabe,
il sature les points forts du recueil à peu près comme le
motif. Il faut plutôt concevoir le recueil (en tant
qu'opération contribuant au sens) comme une
superposition de solidarités-oppositions menant à des associations dont aucune
versification ou poétique d'époque ne pourrait rendre compte.
La métrique, la thématique se construisent en même temps que Romances
sans paroles. Rien ne prédispose en effet l'heptasyllabe à
raconter comment la fatigue amoureuse se transmue en noyade de
l'air, ni l'alexandrin à décrire la marche sur les eaux : rien,
sauf l'organisation d'un recueil unique. Et les différents fils
doivent être tenus en rapport avec cette composition, sans
démembrement.
Reste que la structure achevée apparaît naturellement comme
le terme, la raison d'être de l'organisation. A partir de là
encore, se pose la question d'une possible vectorisation
du recueil. L'un des phénomènes les plus
révélateurs à cet égard est la cumulation propre aux incipit
des Paysages belges, mais on pourrait aussi regarder Beams
comme un résumé de tout le recueil, une récapitulation. Sa
dernière strophe, sorte d'"énoncé idéologique
séparable", traite d'abord le thème dominant des Aquarelles,
celui de la peur et du repos, mais le dernier vers semble achever
le recueil en bouclant le système des clausules. "Elle
reprit la route..." renvoie au motif du voyage, propre aux Paysages
belges, tandis que "... et portait haut la tête"
à la fois s'apparente au desinit de Birds et s'oppose
à ceux des Ariettes I et IX, en jouant sur la
polysémie de "bas" et en faisant écho aux
"hautes feuillées". Le vers, dans son ensemble,
contredisant la fin de Green :
| Et que je dorme un peu puisque vous
reposez. |
Clôture et mémoire de la composition, ce finale nous
suggère que l'opposition entre desinit ne surdétermine pas
arbitrairement la lecture-ensemble des poèmes, mais que le
poème à la fois obéit et commande à la composition. Le début
de Green en donne un autre exemple : la composition ne
serait pas autre chose que l'écriture.
e- la réversibilité, à
nouveau :
Beams est un achèvement, une solution (fût-elle fantasmatique), mais
on ne peut oublier qu'il est aussi le terme d'une régression érotique et que
les Aquarelles sont placées sous le signe de la simplification
et de la palinodie (cf. chapitres sur le lexique et le mètre). On pourrait certainement
être tenté de préférer à ce versant négatif les Ariettes ou le versant
de la langueur. L'étude du lexique a d'ailleurs bien montré les faiblesses possibles
de cette bipartition et les dangers d'une contradiction un peu trop systématique,
qui rendent compte peut-être de la réception inégale réservée aux Romances.
Mais le mètre ne commence à faire sens qu'organisé dans tout le recueil et il
en est de même, pour une large part, des incipit et desinit ou du motif...
La fin de Romances sans paroles renvoie l'impair à
l'inexistence, préfère à l'amour une foi bien incertaine,
ignore les puissances de l'eau profonde, prône le mouvement
sûr, déroulement et surrection. Biffant ainsi ce dont elle
part, la composition a la fragilité des négations, mais aussi
leur force : quand on place au-dessus de tout les Ariettes
ou la première Aquarelle, il faut savoir qu'elles n'ont
été conçues que condamnées — même si c'est par des
poèmes qui ne les feront pas oublier. La négation engendre la
négation de la négation, la revanche, le retour en arrière.
L'impair plus que douteux aura peut-être là toujours plus de
prestige que l'alexandrin.
Nous retombons ainsi dans une sorte de réversibilité : chaque pôle devient
l'envers de l'autre et ne cesse d'y renvoyer. Ainsi les Ariettes évoquent
l'air mais sont la section de la noyade, tandis que l'eau d'Aquarelles
se vaporise en lumière ; les incipit impersonnels des premiers poèmes supposent
un personnel masqué tandis que les pronoms des derniers incipit vont vers une
fausse "non-personne"...
Page d'accueil
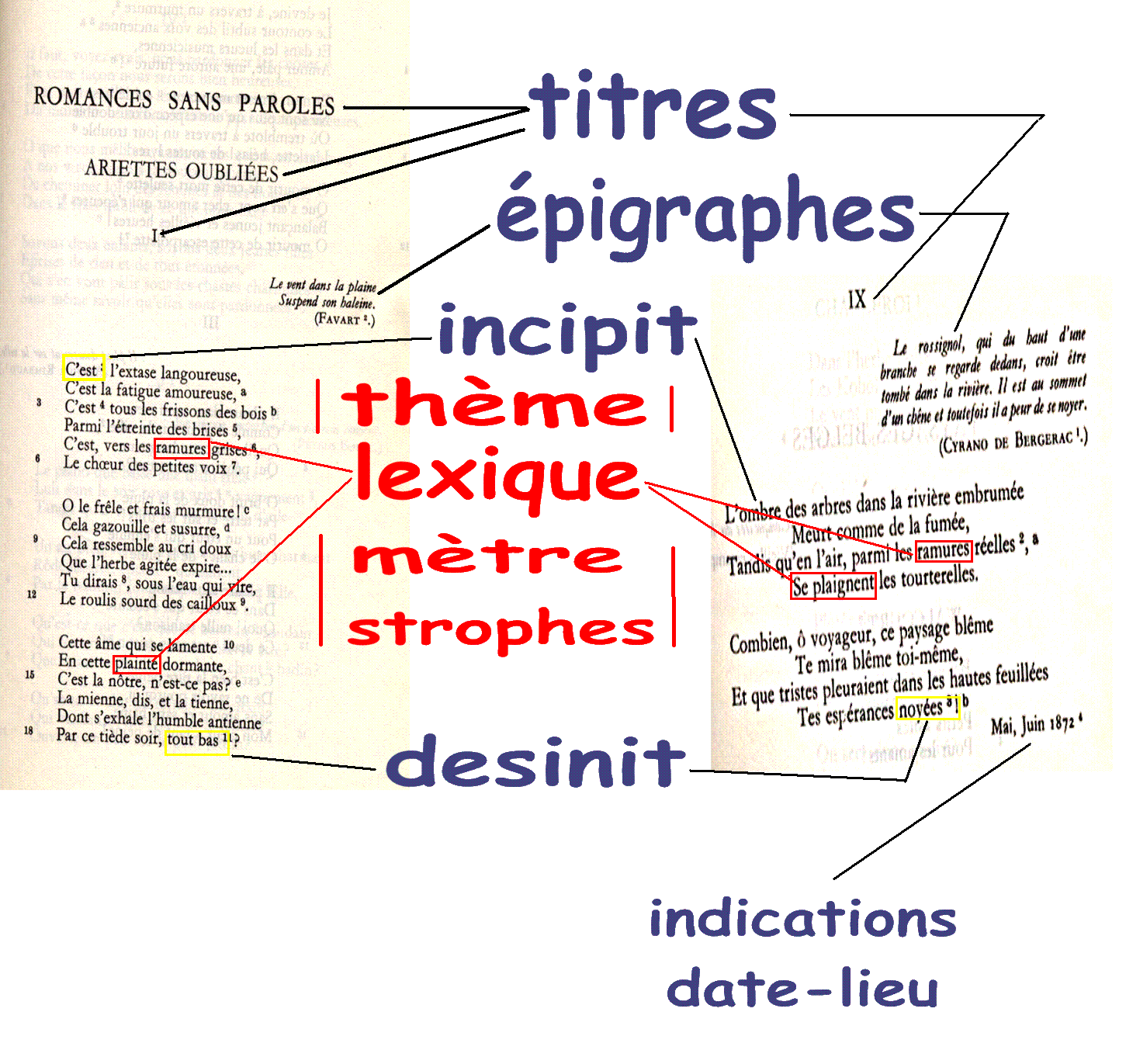 Nous préférons partir de l'organisation textuelle,
des éléments qui, du recueil, forment un livre : titres, épigraphes
et autres indications annexes, incipit et desinit,
récurrences de mètres, de schémas de rimes, de mots. A tout cela, nous ajouterons
un motif qui s'est déjà signalé à notre attention dans les Ariettes
extrêmes : celui de l'eau, de l'arbre
et de l'oiseau. Tous ces éléments, soit internes-externes, soit récurrents,
constituent une palette pour la mise en interaction des poèmes, en liaison avec
le découpage obvie et avec les positions fortes que celui-ci détermine. Chacun
obéissant à sa logique propre, nous les avons passés successivement en revue.
Les convergences qui importent nous semblent être celles qui se décident d'organisation
à organisation, s'il y a vraiment composition. Nous avons donc essayé de ne
pas superposer hâtivement les niveaux et d'attendre plutôt des indices de "coalescence".
Nous préférons partir de l'organisation textuelle,
des éléments qui, du recueil, forment un livre : titres, épigraphes
et autres indications annexes, incipit et desinit,
récurrences de mètres, de schémas de rimes, de mots. A tout cela, nous ajouterons
un motif qui s'est déjà signalé à notre attention dans les Ariettes
extrêmes : celui de l'eau, de l'arbre
et de l'oiseau. Tous ces éléments, soit internes-externes, soit récurrents,
constituent une palette pour la mise en interaction des poèmes, en liaison avec
le découpage obvie et avec les positions fortes que celui-ci détermine. Chacun
obéissant à sa logique propre, nous les avons passés successivement en revue.
Les convergences qui importent nous semblent être celles qui se décident d'organisation
à organisation, s'il y a vraiment composition. Nous avons donc essayé de ne
pas superposer hâtivement les niveaux et d'attendre plutôt des indices de "coalescence".